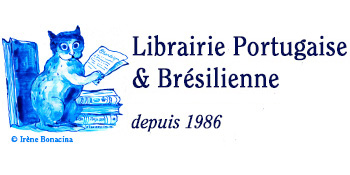MAGELLAN ZOOLOGUE (in : Revue Sigila, n° 32, octobre 2013)
Le secret des cornioles
suivi par
Magellan Buffon et le tapir
Au chapitre 23, de la relation de Pigafetta sur le voyage de Magellan, l’auteur note l’anecdote suivant recueillie sur l’île de Cebu aux Philippines en avril 1521: « À ladite île de ce roi il y a une manière de bêtes portant coques, nommée cornioles, grandes et belles à voir, lesquelles font mourir la baleine. Car la baleine les engloutit toutes vives puis, quand elles sont dedans le corps, elles sortent hors de leur coque et vont manger le cœur de la baleine. Et les gens de ce pays trouvent dedans la baleine ce bestiau en vie près du cœur. Lesquelles bêtes cornioles ont des dents et la peau noire, et leur coque est blanche. Leur chair est bonne à manger et on les appelle laghan. » Cette histoire a longtemps été une énigme pour les commentateurs. Nous l’avons résolue très récemment dans notre édition critique de l’intégrale des sources directes sur le voyage de Magellan : Le mot cornioles est une traduction française de cornioli (pluriel italien de corniolo, littéralement : « petite corne »), terme que l’on trouve dans le seul manuscrit italien de la relation. Dès le début, le terme a été mal compris. Le chroniqueur espagnol López de Gómara, confondant lesdites cornioles et les corneilles, écrit ainsi : « Il y a des poissons qui volent et des oiseaux comme des corbeaux, qu’ils appellent laganes, qui se mettent dans la gueule de la baleine et se laissent avaler ; une fois à l’intérieur, ils mangent leur cœur et les tuent. Ils ont des dents sur leur bec, ou ce qui en tient lieu, et ils sont comestibles. » (Historia general de las Indias, 1552). Or, corniole apparaît dans le vocabulaire moluquois relevé par Pigafetta, traduit par cepot (op. cit., p. 235), c’est-à-dire le mot malais ciput : colimaçon, escargot, coquille. Si Pigafetta connaissait ce mot et sa signification, pourquoi aurait-il créé ce mot : corniolo ? Il observera également ces cornioli sur l’île de Malua (Alor), utilisés comme objets de parure (op. cit., p. 244) : pour nous, il ne fait pas de doute que ce mot, traduit phonétiquement dans les manuscrits français, désigne des nautiles. Le terme laghan, noté par Pigafetta, désigne en langue visaya cet animal, dont la principale espèce est le Nautilus pompilius L. Mentrida (Bocabulario de lengua bisaia…, 1637) recense le terme lagang avec une dé?nition encore vague : « grand escargot de nacre, lui ou sa coquille » ; mais Encarnación (Diccionario español-bisaya, 1852) précise?: « Lagáng : nautile, escargot d’aspect orbiculaire, marin, beau et très ?n ». Nous sommes dans ces îles Philippines au cœur du biotope du nautile, qui y était autrefois beaucoup plus commun qu’aujourd’hui, avant que sa pêche devienne intensive pour fournir les boutiques de souvenirs. Le nautile est connu pour sa magnfique coquille en spirale, qui en fait un fossile vivant très proche des célèbres « cornes d’Ammon », les ammonites. Mais la présence de cornioli dans les « baleines » pose de nouvelles questions. Cette histoire, à notre connaissance, n’a pas été puisée dans une littérature préexistante. Elle semble bien résulter de conversations avec les insulaires, lesquels, en observant des cachalots échoués, auraient pu faire de curieux rapprochements, du moins dans la compréhension qu’en eut Pigafetta. Nous pensons qu’une confusion s’est créée entre certaines espèces de calamars et les nautiles, hypothèse qui permet d’expliquer ce passage de la relation. Les calamars sont en effet la nourriture de prédilection des cachalots. Ces céphalopodes ont des tentacules et surtout un bec de chitine (ce bec n’est pas digéré et se retrouve dans l’intestin des cachalots, agglutiné dans l’ambre gris, lequel est régulièrement excrété). Le nautile est aussi un céphalopode et, la coquille externe mise à part, il partage avec ses congénères de nombreux traits communs : tentacules, yeux et bec (bien que dans son cas, celui-ci soit très réduit et enfoui dans la masse buccale). Tout se complique quand Pigafetta rapporte que les cornioli «sortent hors de leur coque et vont manger le cœur de la baleine» : le cachalot ne se nourrissant pas de nautiles, on ne retrouve évidemment pas leurs coquilles dans ses viscères. En revanche, on peut y découvrir les becs des calamars, et éventuellement, s’ils n’ont pas été encore digérés, des morceaux de tentacules ou d’autres organes. Les deux mollusques ont, à des échelles différentes, une anatomie comparable. Les calamars dont se nourrissent les cachalots étant des espèces pélagiques, c’est-à-dire vivant dans les grands fonds, sans doute inconnus des indigènes, il est naturel que ces derniers, en observant des cachalots échoués (il semble qu’ils ne les chassaient pas), aient imaginé que les fragments retrouvés dans les cadavres provenaient de nautiles, certes de bonne taille (« cornioli grandi » dans le ms. Italien de Pigafetta), mais dont la morphologie leur était familière. Et la présence de nombreux becs non digérés ou agglutinés a pu faire croire qu’ils mangeaient « le cœur de la baleine », cause apparente de l’échouage puis de la mort du cétacé. Pigafetta mêle ainsi dans le même paragraphe, de manière erronée, plusieurs informations exactes, dont la richesse a certainement échappé à ses contemporains et est restée longtemps ignorée. Pour preuve, les nautiles vivants et leurs becs ne seront décrits pour la première fois qu’en 1705 par Rumphius, dans sa monumentale Histoire naturelle d&rsqu